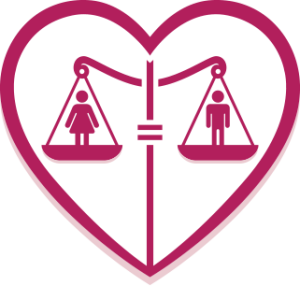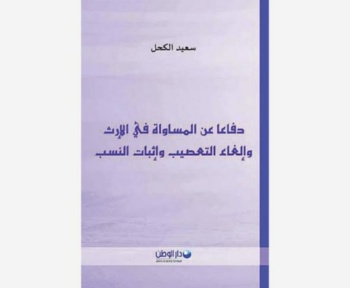STOP Harcèlement » : Comprendre, réagir, protéger. Un guide digital clair et pratique, adapté au Maroc, pour dire non au harcèlement au travail et défendre vos droits. Informez-vous, agissez et faites évoluer votre environnement professionnel.
Regarder et partager la Vidéo STOP Harcèlement (darija) https://www.parity.ma/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d8%b4/
STOP HARCÈLEMENT – Guide
Résumé
Le harcèlement au travail demeure, en 2025, un enjeu majeur pour les droits humains et la santé au travail, touchant plus d’un.e travailleuse.r sur cinq dans le monde. Il englobe des comportements physiques, psychologiques et sexuels qui portent atteinte à la dignité, à la sécurité et à la santé des personnes.
Constats clés
- Ampleur mondiale : Selon l’OIT, 22,8 % des travailleuse.rs ont subi au moins une forme de harcèlement dans leur vie professionnelle, avec des disparités régionales (34 % dans les Amériques, 25 % en Afrique et en Europe, 14 % dans les États arabes).
- Au Maroc : Les données du HCP (2019) montrent que 15 % des femmes actives ont été victimes de violences ou de harcèlement au travail en un an, principalement sous forme de harcèlement psychologique ou de discrimination économique.
- Conséquences graves : Les victimes souffrent fréquemment de troubles psychologiques (anxiété, dépression, stress post-traumatique), de problèmes somatiques (hypertension, troubles digestifs) et voient leur vie familiale et sociale affectée. Les organisations subissent des pertes en productivité, une hausse de l’absentéisme, un turnover élevé et une dégradation du climat social.
Cadre normatif et juridique
- International : La Convention OIT n°190 (2019) constitue la référence majeure, affirmant le droit à un environnement de travail exempt de violence et de harcèlement.
- Maroc : Le Code du travail (art. 40) reconnaît le harcèlement comme une faute grave et la loi 103-13 incrimine le harcèlement sexuel.
Recommandations phares
- Prévenir en amont :
- Élaborer une politique anti-harcèlement claire.
- Former les managers et sensibiliser l’ensemble des employé.e.s.
- Mettre en place des mécanismes d’écoute (référent.e.s, comités de prévention).
- Réagir efficacement :
- Garantir des canaux de signalement sûrs (confidentiels et accessibles).
- Protéger et accompagner les victimes (soutien psychologique, aménagements).
- Sanctionner fermement les auteurs, jusqu’au licenciement ou aux poursuites pénales.
- Promouvoir une culture respectueuse :
- Impliquer la direction dans une tolérance zéro au harcèlement.
- Encourager les témoins à signaler les abus.
- Intégrer le respect et l’équité dans la culture organisationnelle.
Ressources incluses dans le guide
- Fiches pratiques (pour les employeur.ses et salarié.es : reconnaître, signaler, agir).
- Encadrés explicatifs (définitions, exemples de jurisprudence, profils des victimes).
- Tableaux et graphiques (statistiques mondiales, régionales et marocaines).
- Adresses de liens utiles (OIT, OMS, HCP, ministère du Travail marocain, associations locales).
Conclusion
Le harcèlement au travail n’est pas une fatalité. Il nécessite une mobilisation collective :
- des employeuse.rs, qui doivent garantir un environnement sûr ;
- des travailleuse.rs, qui doivent être sensibilisé.e.s et protégé.e.s ;
- des pouvoirs publics, qui doivent renforcer les contrôles et le soutien aux victimes.
En appliquant les normes internationales et en s’appuyant sur les bonnes pratiques documentées dans ce guide, il est possible de transformer les lieux de travail en espaces de respect, de dignité et de coopération, au Maroc comme ailleurs.
1. Introduction
Le harcèlement au travail est désormais reconnu comme un problème mondial majeur portant atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité des travailleuses et des travailleurs. En 2019, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté la Convention n°190, première norme internationale affirmant le droit de chacun à un environnement de travail exempt de violence et de harcèlement. Malgré cette avancée, les comportements de harcèlement restent très répandus: plus d’un.e travailleuse.r sur cinq dans le monde a subi au moins une forme de violence ou de harcèlement au cours de sa vie professionnelle. Ces agissements incluent aussi bien des agressions physiques, des attaques psychologiques (intimidation, menaces, brimades) que des comportements à connotation sexuelle. Ils peuvent viser tout individu, quel que soit le secteur ou le pays, et créent un climat de travail toxique aux conséquences graves pour les personnes et les organisations.
| Encadré : Définition du harcèlement au travail – Selon l’OIT, l’expression « violence et harcèlement dans le monde du travail » désigne un ensemble de comportements inacceptables qu’ils se produisent une seule fois ou de manière répétée, qui visent, entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des dommages physiques, psychologiques, sexuels ou économiques. Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les autres formes d’abus de pouvoir au travail entrent dans cette définition. Cette définition large couvre toutes les formes de harcèlement (physique, psychologique, sexuel) et souligne que même un fait isolé peut être condamné, sans attendre la répétition. Le présent guide utilisera cette définition-cadre pour aborder l’ensemble des situations de harcèlement au travail. |
Objectif du guide : Ce guide vise à fournir aux lectrices et aux lecteurs une référence complète et à jour sur le harcèlement en milieu professionnel. Il s’appuie d’abord sur les référentiels internationaux (OIT, Organisation mondiale de la Santé – OMS, Organisation de coopération et de développement économiques – OCDE, etc.) pour présenter les normes, données et bonnes pratiques reconnues à l’échelle mondiale. Ensuite, pour chaque chapitre, un focus sur le contexte marocain sera proposé lorsque pertinent, afin de zoomer sur la réalité nationale (cadre légal marocain, statistiques locales, initiatives spécifiques). L’accent est mis sur une navigation fluide par sections et sur une présentation adaptée au web : titres et sous-titres clairs, paragraphes concis, intégration visuelle d’encadrés, de graphiques et de tableaux au fil du texte, ainsi que des liens utiles vers des ressources externes. Au-delà des informations factuelles, le guide intègre également des fiches pratiques et encadrés explicatifs pour aider tant les employeuse.rs que les employé.e.s à reconnaître, prévenir et gérer les situations de harcèlement. L’objectif final est de sensibiliser toutes les parties prenantes sur l’ampleur du phénomène, ses conséquences humaines et organisationnelles, et de partager des outils concrets pour instaurer des milieux de travail sains et sécurisés.
2. Cadre Juridique et Normatif
Cette section présente le cadre juridique qui sous-tend la lutte contre le harcèlement au travail, du niveau international au niveau national marocain. Elle rappelle d’abord les normes et engagements internationaux en la matière, puis détaille la manière dont le Maroc a intégré ces principes dans sa législation interne. Comprendre ces repères normatifs est essentiel pour situer les droits et obligations de chacun face au harcèlement.
2.1 Normes internationales : conventions et standards de référence
Au cours des deux dernières décennies, la communauté internationale a fortement renforcé le corpus normatif encadrant la prévention du harcèlement et des violences au travail. L’OIT joue un rôle central avec plusieurs instruments clés. La Convention n°190 (2019) sur la violence et le harcèlement est la première convention internationale juridiquement contraignante sur ce sujet, affirmant “le droit de toute personne à un environnement de travail sûr et exempt de violence et de harcèlement” et invitant les États à adopter une approche inclusive et globale de prévention. Elle s’accompagne de la Recommandation n°206 qui précise les mesures pratiques de mise en œuvre. À ce jour, une trentaine de pays ont ratifié la Convention 190, s’engageant à aligner leur législation sur ses exigences – le Maroc n’a pas encore ratifié cette Convention -. Par ailleurs, des conventions antérieures de l’OIT (par ex. la Convention n°111 sur la discrimination, la Convention n°155 sur la sécurité et la santé au travail) et les Objectifs de développement durable de l’ONU (ODD n°5 sur l’égalité des sexes et n°8 sur le travail décent) fournissent un cadre général encourageant l’élimination du harcèlement et des violences basées sur le genre dans le monde du travail.
D’autres organisations internationales contribuent également à définir des référentiels. L’OMS, dans ses directives sur la santé mentale au travail publiées en 2022, identifie les comportements négatifs comme le harcèlement ou l’intimidation parmi les principaux risques psychosociaux à combattre. L’OMS et l’OIT ont conjointement appelé à agir concrètement en soulignant que les environnements de travail délétères (où sévissent surcharge, intimidation, violences psychologiques) nuisent gravement à la santé mentale des salarié.es. De son côté, l’OCDE met l’accent sur la responsabilité sociale des entreprises et la qualité de vie au travail : dans ses principes directeurs et études sur le bien-être au travail, elle incite les employeuse.rs à mettre en place des politiques proactives pour prévenir toute forme de violence ou de harcèlement, y voyant un facteur clé de productivité et d’attractivité économique.
| Encadré : Convention OIT n°190 – points-clés – Adoptée en juin 2019, la Convention 190 définit la violence et le harcèlement au travail comme « un ensemble de comportements, pratiques ou menaces qui visent, entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner des dommages physiques, psychologiques, sexuels ou économiques ». Elle couvre toutes les travailleuses et travailleurs (salarié.e.s, stagiaires, travailleuses et travailleurs informelles, etc.) et toutes les situations de travail (dans et en dehors du lieu de travail, déplacements professionnels, communications liées au travail). Elle demande aux États de : (a) interdire en droit le harcèlement au travail, (b) prévenir par des politiques et actions de sensibilisation, (c) protéger et accompagner les victimes, (d) prévoir des sanctions effectives, et (e) étendre la protection aux travailleuses et travailleurs les plus vulnérables (femmes, jeunes, travailleuses et travailleurs précaires, etc.). La Recommandation 206 donne des orientations sur la formation, les mécanismes de plainte, la négociation collective, et inclut la prise en compte des violences domestiques ayant un impact sur le travail. |
Au-delà des conventions, des codes de conduite volontaires et initiatives sectorielles existent (par exemple, charte de l’ONU pour un environnement de travail respectueux, protocoles dans certaines industries à haut risque comme la santé ou l’éducation). Toutes ces normes internationales convergent vers un message clair : tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement au travail et devoir pour les employeuse.rs de garantir un milieu sûr et respectueux.
2.2 Cadre légal marocain : lois et dispositifs nationaux
Le Maroc, en tant qu’État membre de l’OIT et engagé dans les conventions internationales relatives au travail, a développé son propre arsenal juridique pour lutter contre le harcèlement professionnel. Le Code du travail marocain (loi n°65-99), entré en vigueur en 2004, comporte des dispositions explicites à ce sujet. Notamment, l’article 40 du Code du travail qualifie de faute grave de l’employeur.se « tous actes de violence ou harcèlement commis à l’encontre du/de la salarié.e », y compris les insultes, agressions physiques, incitations immorales ou harcèlement sexuel. Cela signifie que si un.e employeur.se se rend coupable de harcèlement, la.e salarié.e est en droit de quitter son poste en considérant qu’il s’agit d’un licenciement abusif de la part de l’employeur.se, et non d’une démission – il s’agit juridiquement d’une résiliation du contrat aux torts de l’employeur.se. Cette reconnaissance par la loi marocaine place la barre haut en termes de responsabilité de l’employeur.se.
En parallèle, le Code pénal marocain réprime le harcèlement sexuel et certaines formes de harcèlement moral. Depuis les amendements introduits (notamment par la loi 103-13 de 2018 sur les violences faites aux femmes), le harcèlement sexuel est un délit passible de peines d’amende et d’emprisonnement, y compris lorsque ces faits se produisent sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail. Par exemple, le fait d’importuner autrui par des actes, propos ou signaux de nature sexuelle ou à des fins sexuelles est puni par la loi. Cette incrimination vise essentiellement à protéger les femmes, majoritairement victimes de harcèlement sexuel au travail, mais s’applique à toute victime quelle que soit son identité.
Le cadre réglementaire national a également évolué pour mettre en place des mécanismes de prévention. Des textes relatifs à la santé et sécurité au travail encouragent l’employeur.se à évaluer les risques psychosociaux et à prendre des mesures préventives contre le stress et le harcèlement. De plus, des circulaires administratives ont été émises pour le secteur public marocain afin de combattre le harcèlement en milieu professionnel (par exemple, en instituant des cellules d’écoute ou en facilitant les procédures de plainte au sein des administrations).
| Encadré : Que dit la loi marocaine ? – Outre le Code du travail et le Code pénal, d’autres dispositifs soutiennent la lutte contre le harcèlement : (a) La Constitution marocaine (2011) consacre l’égalité des sexes et le droit à l’intégrité physique et morale, ce qui peut fonder le droit à un travail sans harcèlement. (b) La loi n°19-02 relative aux violences faites aux femmes renforce la protection des victimes, notamment en milieu domestique et public, et sensibilise indirectement sur les comportements sexistes au travail. (c) Les tribunaux marocains ont déjà reconnu la notion de harcèlement déguisé : la Cour de cassation a jugé qu’un ensemble d’agissements subtils (mise au placard, changements abusifs de conditions de travail) peut constituer un harcèlement justifiant un départ du salarié aux torts de l’employeur.se. En somme, le salarié marocain dispose d’une base légale pour se protéger du harcèlement et obtenir réparation, même si la preuve des faits peut rester délicate. |
| Fiche Pratique : Droits du/de la salarié·e harcelé·e au Maroc(Récapitulatif juridique et recours disponibles)Objectif de la fiche : Informer les salarié·e·s sur leurs droits en cas de harcèlement (moral, sexuel ou violence fondée sur le genre) et sur les recours internes et externes prévus par la loi marocaine.1. Droit de signalement et protection contre les représaillesDroit de saisir l’employeur.se : Toute victime peut signaler un cas de harcèlement à la direction, aux ressources humaines ou via le mécanisme interne de plainte.Protection contre les représailles : La loi interdit toute sanction ou mesure discriminatoire envers un·e salarié·e qui a signalé de bonne foi un harcèlement (Code du travail, art. 40).2. Droit de retraitEn cas de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, le/la salarié·e peut exercer son droit de retrait (quitter temporairement son poste sans sanction), en informant immédiatement l’employeur (Code du travail, art. 24 et suivants).3. Droit de dépôt de plainte pénalePlainte auprès du parquet : La victime peut déposer plainte auprès du ministère public.Articles applicables :Code pénal, art. 503‑1, 503‑1‑1 et 503‑1‑2 : harcèlement sexuel (y compris par abus d’autorité, dans l’espace public et en ligne).Loi 103‑13 : renforce les sanctions contre les violences faites aux femmes et prévoit des mesures de protection.4. Droit à la réparationIndemnisation : Si le harcèlement cause un préjudice (psychologique, physique ou économique), la victime peut obtenir réparation devant les tribunaux (dommages et intérêts).Licenciement abusif : Si le/la salarié·e démissionne pour harcèlement, cela peut être requalifié en licenciement abusif ouvrant droit à indemnités (Code du travail, art. 40).5. Droit à l’accompagnement et au soutienRecours aux inspections du travail : Les inspecteurs/trices peuvent enquêter et assister la victime.ONG et associations spécialisées : Aide juridique, psychologique et sociale.Mesures de protection : Ordonnances de protection (éloignement de l’agresseur, etc.) prévues par la loi 103‑13.Points clés à retenirTolérance zéro : Le harcèlement est interdit et pénalement sanctionné au Maroc.Recours multiples : Internes (RH, inspection du travail) et externes (justice, ONG).Protection garantie : Le/la salarié·e ne peut être sanctionné·e pour avoir dénoncé un harcèlement. |
Dans chaque chapitre qui suit, un éclairage particulier sur l’application de ces lois au Maroc sera proposé lorsque c’est pertinent – que ce soit en termes de statistiques de plaintes, d’exemples jurisprudentiels ou d’initiatives locales de sensibilisation. Le cadre juridique, bien que fondamental, n’est qu’un outil : encore faut-il qu’il soit connu et utilisé par les actrices et les acteurs et actrices du monde du travail.
3. Statistiques et Tendances
Malgré la sensibilité du sujet, la documentation statistique sur le harcèlement au travail s’est considérablement enrichie depuis les années 2000. Les enquêtes récentes permettent de mieux cerner l’ampleur du phénomène à l’échelle mondiale, d’identifier les populations les plus touchées, ainsi que d’observer les différences selon les régions du globe. En parallèle, des données spécifiques émergent pour le Maroc, grâce à des études nationales, permettant de situer le pays par rapport aux tendances internationales. Cette section présente les principales statistiques globales, régionales et nationales disponibles sur la période 2000–2025, en mettant en avant quelques tableaux et graphiques illustratifs.
3.1 Aperçu mondial : un phénomène répandu mais longtemps sous-estimé
Au niveau mondial, le harcèlement au travail touche une proportion significative de travailleuses et de travailleurs, toutes formes confondues. Selon la première enquête mondiale menée conjointement par l’OIT, la Fondation Lloyd’s Register et Gallup en 2021, 22,8 % des personnes ayant un emploi (soit environ 743 millions de travailleurs) déclarent avoir subi au moins une forme de violence ou de harcèlement au cours de leur vie professionnelle. Ce chiffre, inédit par son périmètre, confirme que plus d’un.e travailleuse.r sur cinq est concerné.e. L’étude révèle également que la plupart du temps, les faits ne sont pas isolés : 61 % des victimes déclarent avoir subi des actes de harcèlement à répétition (au moins trois incidents au cours de leur carrière). En outre, près d’un tiers des victimes (31,8 %) ont été exposées à plus d’une forme de violence ou de harcèlement, traduisant l’entremêlement possible des abus (par ex. une même personne subissant à la fois du harcèlement moral et des attouchements).
Du point de vue des formes de harcèlement, l’enquête mondiale confirme que le harcèlement d’ordre psychologique est le plus courant: près d’un.e travailleuse.r sur cinq dans le monde (17,9 %) a subi insultes, intimidations, humiliations ou menaces au travail. Viennent ensuite le harcèlement physique (agressions, bousculades, etc.) qui a touché environ 8,5 % des travailleuse.rs, puis le harcèlement sexuel, signalé par 6,3 % des personnes en emploi. Ces pourcentages peuvent sembler faibles au regard de la médiatisation du sujet, mais ils représentent des centaines de millions de personnes (env. 580 millions exposés au harcèlement psychologique, 277 millions au physique, plus de 200 millions au sexuel). De plus, ils sont des moyennes mondiales – la réalité varie fortement selon le genre et d’autres facteurs : les femmes sont ainsi nettement plus susceptibles de subir des formes de harcèlement sexuel (8 % des femmes employées contre 5 % des hommes), tandis que les travailleuse.rs jeunes (15–24 ans) sont plus souvent victimes de toutes formes de harcèlement que leurs aîné.es. Ces disparités montrent l’importance d’aborder le problème sous l’angle de la prévention ciblée (par exemple, cibler le harcèlement sexuel via des actions spécifiques pour protéger les jeunes femmes, population particulièrement à risque).
Sur le plan de l’évolution temporelle (2000–2025), il est difficile d’établir des tendances précises faute de données historiques globales comparables. Néanmoins, on constate une prise de conscience accrue ces dernières années, alimentée par des mouvements comme #MeToo, qui a encouragé la libération de la parole sur le harcèlement sexuel. Le nombre de cas rapportés tend à augmenter à mesure que les victimes osent davantage témoigner et que les entreprises mettent en place des dispositifs de signalement. Certains indicateurs indirects – comme les journées de travail perdues pour causes psychologiques – soulignent le coût croissant du phénomène : on estime à 12 milliards le nombre de jours de travail perdus chaque année dans le monde à cause de la dépression et de l’anxiété, un coût d’environ 1000 milliards de dollars pour l’économie mondiale. Une part non négligeable de ces troubles mentaux au travail est liée à des situations de harcèlement ou de violence subies, qui aggravent le stress et la détresse des employé.e.s. Ainsi, plus qu’une progression ou régression simple, c’est surtout la visibilité du harcèlement et la reconnaissance de son impact qui ont fortement progressé entre 2000 et 2025.
3.2 Variations régionales : comparaison des taux de harcèlement
Le vécu du harcèlement au travail présente des différences notables d’une région du monde à l’autre. La grande enquête OIT–Gallup (2021) met en évidence des écarts de prévalence régionale assez marqués. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la proportion de travailleuse.r.s ayant subi au moins une forme de harcèlement durant leur vie professionnelle est la plus élevée dans la région des Amériques (34,3 %), suivie de l’Afrique (25,7 %), de l’Europe & Asie centrale (25,5 %), puis de l’Asie-Pacifique (19,2 %). La région des États arabes enregistre le taux le plus bas, avec 13,6 % – ce chiffre relativement faible pouvant s’expliquer en partie par une sous-déclaration liée à des tabous plus forts ou à un manque de dispositifs de plainte.
Figure 1 : % de personnes ayant déclaré avoir subi une forme de violence ou de harcèlement au travail, par région du monde (enquête OIT 2021).
Le tableau ci-dessous récapitule ces taux de prévalence par grandes régions, en les comparant à la moyenne mondiale :
| Région | Taux de travailleuse.rs ayant déclaré avoir été exposés au Harcèlement |
| Monde (moyenne) | 22,8 % |
| Amériques | 34,3 % |
| Afrique | 25,7 % |
| Europe & Asie centrale | 25,5 % |
| Asie & Pacifique | 19,2 % |
| États arabes | 13,6 % |
On observe ainsi que les Amériques (incluant Amérique du Nord, Centrale et du Sud) se distinguent par un taux de harcèlement déclaré sensiblement supérieur aux autres régions. Cela peut refléter une réalité plus dure dans certains pays d’Amérique Latine où la violence au travail est élevée, mais aussi une plus grande liberté de parole en Amérique du Nord sur ces sujets, faussant en partie la comparaison avec des régions où le phénomène reste caché. L’Afrique et l’Europe affichent des niveaux comparables (environ un quart des travailleuse.rs concernés). Dans le détail, il est intéressant de noter que pour l’Europe, les enquêtes nationales montrent une variabilité interne : par exemple, les pays nordiques ont longtemps eu des taux déclarés élevés de harcèlement moral (car la sensibilisation y est forte), tandis que les pays d’Europe de l’Est rapportaient moins de cas, possiblement par manque de dénonciation. Enfin, les États arabes présentent le taux le plus bas, probablement lié à un mélange de facteurs socio-culturels (réticence à signaler ou à porter plainte, relations de travail très hiérarchisées) et légaux (peu de protection explicite jusqu’à récemment).
Il faut toutefois interpréter ces chiffres avec prudence. Un taux plus faible ne signifie pas nécessairement que les milieux de travail sont plus sûrs, cela peut indiquer que le phénomène est moins rapporté ou reconnu. L’OIT souligne que la violence et le harcèlement au travail sont présents dans toutes les régions du monde et que la priorité est de construire une culture de prévention universelle, partagée au-delà des frontières. Les entreprises multinationales, par exemple, ont intérêt à appliquer les mêmes standards anti-harcèlement dans l’ensemble de leurs filiales, indépendamment des tolérances locales, afin de garantir un traitement égal des salariés où qu’ils se trouvent.
3.3 Focus sur le Maroc : état des lieux statistique
En ce qui concerne le Maroc, les données disponibles indiquent que le harcèlement au travail y est un phénomène bien réel, quoique longtemps peu étudié spécifiquement. L’enquête nationale de référence est celle menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) en 2019 sur la violence à l’égard des femmes. Ses résultats, publiés en 2020, offrent un aperçu de la situation dans le milieu professionnel du point de vue des femmes (population étudiée : femmes de 15 à 74 ans) : 15 % des femmes actives occupées déclarent avoir subi une forme de violence ou de harcèlement au travail au cours des 12 mois précédents. Ce chiffre inclut toutes formes de violences (psychologiques, physiques, sexuelles, économiques) exercées sur le lieu de travail ou pendant l’exercice de son travail. Il est notablement plus faible que la prévalence globale de la violence faite aux femmes tous contextes confondus (57 % des Marocaines ont subi au moins un acte de violence en un an, en comptant le milieu familial, public, etc. ). Cela suggère que, dans la vie d’une femme marocaine, les violences les plus courantes surviennent dans la sphère conjugale ou familiale. Néanmoins, 15 % en contexte professionnel reste un taux préoccupant : 1 femme active sur 6 à 7 est concernée chaque année par du harcèlement ou de la violence au travail.
L’enquête du HCP apporte des précisions instructives sur la nature des abus subis au travail. Elle indique que la grande majorité (83 %) des actes de violence rapportés par des femmes sur leur lieu de travail relèvent soit de violences psychologiques (49 % des cas), soit de discrimination économique (34 % des cas). Les violences psychologiques incluent le harcèlement moral (insultes, humiliations, intimidation, pression excessive…), tandis que la discrimination économique renvoie par exemple au non-paiement de salaires, aux inégalités de traitement ou au refus de droits (congés, promotions) sur des critères injustes. En revanche, les formes de violence physique et sexuelle représentent environ 17 % des cas dans le milieu du travail, d’après cette enquête – un pourcentage relativement bas comparé à d’autres contextes comme l’espace public où le harcèlement sexuel prédomine (49 % des violences subies par les femmes dans la rue sont du harcèlement sexuel). Cela peut s’expliquer par le fait que les femmes actives marocaines sont souvent dans des environnements où la mixité est moindre ou sous surveillance, mais aussi par une possible réticence à signaler les attouchements ou propositions sexuelles subies au travail.
L’enquête HCP de 2019 fait suite à une précédente enquête de 2009, ce qui permet quelques comparaisons générales sur la décennie. Globalement, la tendance est à la baisse dans la prévalence de la violence faites aux femmes, passée de 63 % en 2009 à 57 % en 2019. Dans le milieu professionnel spécifiquement, les résultats de 2009 ne sont pas détaillés dans le communiqué, mais on peut supposer une évolution similaire ou stable. Par ailleurs, les prises de conscience récentes (campagnes contre le harcèlement sexuel, nouveaux textes de loi en 2018) laissent espérer une amélioration progressive de la situation de 2019 à 2025. Les données administratives, comme le nombre de plaintes déposées pour harcèlement, restent éparses ; toutefois, on relève une augmentation des signalements suite à l’entrée en vigueur de la loi 103-13 (par ex. plus de plaintes pour harcèlement sexuel enregistrées par les parquets en 2019–2020 qu’avant). Le développement d’enquêtes spécifiques sur les conditions de travail (par le ministère du Travail ou des ONG) devrait permettre de suivre plus finement l’évolution du harcèlement au travail au Maroc.
| Encadré : Profil des femmes les plus exposées au harcèlement au travail au Maroc – D’après l’enquête HCP 2019, certains groupes de femmes actives sont davantage touchés dans le milieu professionnel : les femmes divorcées (22 % d’entre elles ont subi des violences au travail en un an), les femmes salariées (21 % – plus que les travailleuses indépendantes), les femmes urbaines (18 % – plus qu’en milieu rural) et les jeunes actives de 15 à 34 ans (19 % – plus que les plus âgées). Par ailleurs, dans 41 % des cas reportés, l’auteur des violences était un supérieur hiérarchique, et dans 29 % des cas un collègue. Ces chiffres soulignent que le harcèlement au travail au Maroc revêt majoritairement un caractère interne à l’entreprise (relations de pouvoir ou de travail entre collègues) et qu’il touche particulièrement les populations féminines potentiellement déjà vulnérables (jeunes, divorcées). |
4. Conséquences du harcèlement
Le harcèlement au travail n’est pas un « mal léger » : il provoque des répercussions profondes aussi bien sur la santé et la psychologie des victimes que sur leur entourage familial, sur leurs collègues et sur la performance globale des organisations. Dans cette section, nous examinons d’une part les impacts sur la victime elle-même, tant au niveau psychologique que physique, sans oublier les effets sur sa vie personnelle et familiale (section 4.1). D’autre part, nous analysons les impacts du harcèlement sur le collectif de travail et le climat social dans l’entreprise (section 4.2), c’est-à-dire comment un cas de harcèlement, au-delà de la victime, peut perturber l’équipe, dégrader l’atmosphère de travail et nuire à l’organisation dans son ensemble. Chaque sous-section intègre des données et des exemples pour illustrer ces conséquences, et met en lumière le coût élevé du harcèlement, humainement et économiquement.
4.1 Impacts psychologiques et physiques sur la victime et son entourage
Être la cible de harcèlement au travail constitue une épreuve psychologique majeure. Les victimes développent très souvent des symptômes de détresse psychologique dès les premiers temps du harcèlement : nervosité, irritabilité, anxiété chronique, troubles du sommeil, perte de confiance en soi, ou encore manifestations de stress physique comme les maux de tête, troubles digestifs ou douleurs musculaires. Ces symptômes initialement réversibles peuvent s’aggraver si la situation de harcèlement perdure sans soutien ni intervention. Au bout de quelques mois de harcèlement continu, de véritables troubles psychiques ou somatiques peuvent apparaître : dépression installée, syndrome d’épuisement professionnel (burn-out), troubles anxieux, voire état de stress post-traumatique dans les cas les plus graves. Des études cliniques montrent qu’un harcèlement prolongé peut conduire la victime à une névrose traumatique : reviviscences incessantes des humiliations subies, terreur à l’idée de se rendre au travail, cauchemars, troubles de la mémoire et de la concentration, sentiment de honte et de culpabilité envahissant. À plus long terme, les cas extrêmes peuvent aller jusqu’à des atteintes profondes de la personnalité (dépression sévère, idées paranoïaques, conduites addictives) et même des tendances suicidaires. Malheureusement, des suicides liés à des situations de harcèlement au travail ont été documentés dans divers pays, révélant l’issue tragique que peut avoir l’absence de prise en charge.
Parallèlement à ces effets psychologiques, le corps somatise fréquemment le stress du harcèlement. Des troubles physiologiques tels que l’hypertension artérielle, les ulcères ou autres troubles digestifs, des troubles dermatologiques (eczéma, psoriasis déclenchés par le stress), ou une vulnérabilité accrue aux infections (du fait d’un affaiblissement immunitaire) sont rapportés chez les victimes de harcèlement moral intense. Parfois, le harcèlement dégénère même en agressions physiques directes, provoquant blessures ou traumatismes, notamment lorsque la violence verbale débouche sur de la violence physique.
Les impacts ne s’arrêtent pas aux portes du travail. La victime emporte chez elle le poids psychologique du harcèlement, ce qui peut entraîner un retentissement sur la vie familiale et sociale. Souvent épuisée, anxieuse ou déprimée, la personne harcelée peut involontairement se replier sur elle-même et montrer de l’irritabilité ou de la tristesse en famille. Les études sur le sujet notent des risques d’isolement social (la victime évite ses amis, n’a plus goût aux activités), un désinvestissement des rôles familiaux (moins de participation à la vie de couple ou à l’éducation des enfants, par manque d’énergie), et l’apparition de conflits familiaux dus à l’incompréhension ou à la tension accumulée. L’entourage est souvent démuni face à la souffrance de la victime, qui peut avoir du mal à verbaliser ce qu’elle vit au travail. Dans certains cas, le conjoint ou les proches, eux-mêmes stressés par ricochet, développent ce qu’on appelle un “traumatisme vicariant”, c’est-à-dire qu’ils subissent indirectement des effets psychologiques négatifs en voyant leur proche harcelé souffrir. Le harcèlement au travail devient ainsi un facteur de détérioration de la qualité de vie globale de la victime et de sa famille.
| Fiche pratique – Reconnaître les signes de détresse chez une victime de harcèlement : Il n’est pas toujours facile pour l’entourage (famille, amis, collègues) d’identifier qu’un proche subit un harcèlement moral ou sexuel au travail. Voici quelques signaux d’alerte courants :Changements soudains d’humeur et de comportement : la personne devient irritable, hypersensible ou au contraire très effacée, alors qu’elle ne l’était pas auparavant.Symptômes de stress inhabituels : troubles du sommeil (insomnies, cauchemars), perte d’appétit ou grignotage excessif, plaintes somatiques fréquentes (maux de ventre, de tête).Désengagement : la personne exprime une démotivation soudaine pour le travail qu’elle aimait, ou montre du désintérêt pour des activités sociales qu’elle appréciait.Discours négatif : elle parle d’elle-même de façon très négative (dévalorisation, culpabilité) ou verbalise une détresse (“Je n’en peux plus de mon boulot”, “ça ne va pas du tout au travail mais je ne peux rien y faire”). Face à ces signes, il est conseillé d’engager le dialogue avec bienveillance et sans jugement, afin d’inciter la personne à mettre des mots sur sa souffrance et, le cas échéant, à chercher de l’aide (voir section 5.2 sur les accompagnements). |
4.2 Impacts sur les relations professionnelles et le climat social de l’organisation
Les répercussions du harcèlement s’étendent au-delà de la personne ciblée : c’est tout le collectif de travail qui peut en pâtir, ainsi que la santé de l’organisation elle-même. Sur le plan humain d’abord, un climat où sévit le harcèlement est un climat toxique qui affecte aussi les collègues – qu’ils soient témoins directs, indirects ou simplement conscients qu’-il se passe quelque chose d’anormal-. Les témoins de harcèlement (autres salariés présents dans l’équipe) peuvent éprouver un stress empathique en voyant leur collègue maltraité.e, ou une anxiété par peur de devenir la prochaine cible. Il n’est pas rare que les équipes développent un sentiment d’insécurité, une perte de confiance envers la hiérarchie si celle-ci laisse faire, et un moral en berne. Par effet d’entraînement, on constate souvent une dégradation des relations entre collègues : certains peuvent éviter de soutenir la victime par crainte pour eux-mêmes, ce qui crée des tensions et de la culpabilité, ou bien le.a harceleur.s.e peut chercher à monter les collègues les uns contre les autres (harcèlement stratégique), sapant ainsi l’esprit d’équipe. Petit à petit, l’ambiance de travail se détériore : méfiance, non-dits, formation de clans, perte de cohésion. Le harcèlement agit en poison insidieux qui rompt le lien de solidarité professionnelle.
Pour l’entreprise ou l’organisation, les conséquences négatives sont multiples et bien documentées. Tout d’abord, le harcèlement conduit souvent à une augmentation de l’absentéisme: la victime s’arrête pour maladie plus fréquemment (arrêts liés au stress, à l’anxiété ou aux troubles somatiques) et les témoins eux-mêmes peuvent chercher à s’absenter pour éviter le climat délétère. À plus long terme, on observe aussi une hausse du turnover (roulement de personnel) : ne supportant plus la situation, la victime finit par quitter l’entreprise (démission, rupture de contrat) et, parfois, d’autres employé.e.s préfèrent partir également pour chercher un environnement plus sain. Ce départ des talents est un coût important pour l’organisation (perte de compétences, coût de recrutement/remplacement).
Ensuite, la performance au travail subit un impact direct. Les victimes de harcèlement voient généralement leur satisfaction et engagement professionnel chuter, entraînant un désinvestissement dans les tâches, un isolement au sein des projets et une baisse de créativité. Il en résulte souvent une diminution de la qualité du travail fourni : difficultés de concentration, erreurs plus fréquentes, prises d’initiative réduites. Même les collègues non harcelés, évoluant dans un mauvais climat, peuvent perdre motivation et efficacité. Au niveau global, le harcèlement mine la productivité de l’entreprise et freine sa performance. L’OIT souligne que ces violences “sapent le bien-être des individus et la productivité des entreprises” partout dans le monde. Des études ont tenté de chiffrer ce coût caché : on parle de plusieurs milliers d’euros par an et par salarié harcelé en pertes de production et frais divers pour l’employeuse.r (arrêts maladie, erreurs, moindre rendement).
Le climat social de l’organisation souffre durablement d’un épisode de harcèlement non résolu. On parle d’altération de la confiance : confiance des employé.e.s envers leur management (s’il a été défaillant dans la protection de la victime), confiance entre collègues. La réputation de l’organisation peut aussi être touchée, surtout si l’affaire devient publique (dans les médias ou sur les réseaux sociaux) – ce qui est de plus en plus fréquent à l’ère de la transparence et de l’exigence de responsabilité sociale. Une entreprise entachée par un scandale de harcèlement pourra rencontrer des difficultés de recrutement (les candidat..e.s la fuient), des démêlés juridiques (procès coûteux, indemnités à verser), sans parler de l’impact sur sa marque employeuse.r et ses relations avec les clients ou partenaires. Enfin, un milieu de travail où le harcèlement est présent est souvent aussi un milieu où d’autres risques augmentent : on note par exemple plus d’accidents du travail dans les environnements stressants ou conflictuels, probablement parce que l’attention diminue et que le climat est imprégné de négligence.
En résumé, les conséquences du harcèlement se répercutent en cascade : individu, équipe, entreprise, et même société (coûts de santé, baisse de productivité nationale). Cela justifie pleinement l’effort de prévention et de lutte, car les bénéfices d’un milieu de travail sain sont nombreux : salariés en bonne santé psychologique, engagement accru, innovation, fidélisation du personnel, etc. La section suivante sera consacrée à ces mesures de prévention et aux façons d’agir pour éviter d’en arriver à de telles dégradations.
| Encadré (étude de cas) : Quand un service implose suite à un harcèlement – Dans une PME marocaine du secteur des services, une cadre expérimentée a subi pendant deux ans le harcèlement continu de son/sa supérieur.e hiérarchique (critiques publiques, mise à l’écart des réunions, objectifs irréalistes suivis de reproches, etc.). La victime a progressivement sombré dans la dépression et s’est mise en arrêt maladie de longue durée. Conséquences dans l’entreprise : son équipe de 5 personnes s’est disloquée en quelques mois – deux collègues proches de la victime ont démissionné par loyauté et écœurement, une autre personne a été licenciée pour faible performance, le service s’est retrouvé en sous-effectif critique. La productivité du département a chuté de 30 %, plusieurs clients importants sont partis à la concurrence en raison de délais non tenus, et l’employeur.se a fini par se séparer du/de la manager harceleur.se, trop tard. Ce cas illustre comment un seul manager toxique peut “faire imploser” une équipe entière, avec un coût financier et humain énorme pour l’entreprise. En l’occurrence, il a fallu près de 18 mois à la PME pour recruter et reformer une équipe opérationnelle, regagner la confiance des clients perdus et rétablir une ambiance de travail acceptable. |
5. Prévention et Gestion du Harcèlement
Face à l’ampleur et à la gravité des conséquences du harcèlement au travail, il est impératif d’agir à tous les niveaux pour prévenir ces situations et, si elles surviennent, les gérer efficacement. Ce cinquième chapitre est orienté vers l’action. Il décrit d’abord les mesures de prévention à mettre en place au sein des organisations (section 5.1), puis s’intéresse aux dispositifs de signalement et d’accompagnement des victimes et témoins (section 5.2), et enfin au cadre de sanction et de recours contre les auteurs de harcèlement (section 5.3). L’approche se veut pragmatique, avec des recommandations concrètes inspirées des guides internationaux (OIT, OMS…) et des bonnes pratiques observées. Des fiches pratiques seront intégrées pour servir de checklist aux employeur.es et salarié.es, et des encadrés explicatifs apporteront un éclairage sur certains outils ou initiatives qui ont fait leurs preuves.
5.1 Mesures de prévention en milieu de travail
La prévention est la pierre angulaire d’une stratégie anti-harcèlement efficace. Il s’agit d’intervenir en amont pour empêcher que des situations de harcèlement ne se développent. Les employeuse.rs ont, à cet égard, un rôle central et une obligation morale (sinon légale) de garantir un environnement de travail sain. Voici les principales mesures préventives à envisager :
- Élaborer et diffuser une politique interne claire : chaque entreprise devrait formaliser une charte ou politique anti-harcèlement définissant sans ambiguïté ce qu’est le harcèlement (avec exemples concrets de comportements prohibés) et affirmant une tolérance zéro. Ce document, approuvé au plus haut niveau de l’organisation, doit être communiqué à tous les employés. Il inclut généralement les procédures de signalement et les sanctions encourues. Une telle politique fixe le cadre et montre l’engagement de l’employeur.se.
- Sensibiliser et former le personnel : la prévention passe par la connaissance. Il est recommandé d’organiser régulièrement des sessions de formation pour l’ensemble des employés, afin de leur apprendre à reconnaître les signes de harcèlement, connaître leurs droits et obligations, et réagir correctement. Surtout, former les cadres et managers est crucial : l’OMS préconise une formation spécifique des dirigeants pour les outiller à prévenir les environnements de travail stressants et détecter les travailleuse.rs en détresse. Un manager bien formé saura adopter un style de gestion respectueux, désamorcer les conflits naissants et soutenir les subordonnés confrontés à des difficultés, évitant ainsi que ne s’installent des dynamiques de harcèlement.
- Mettre en place des structures d’écoute et de vigilance : de nombreuses organisations se dotent de référent.e.s harcèlement ou de personnes de confiance (souvent au service RH ou externe) vers qui les salarié.e.s peuvent se tourner en cas de malaise. Par ailleurs, constituer un comité de prévention des risques psychosociaux impliquant la direction, les représentant.e.s du personnel et éventuellement la.e médecin du travail peut aider à surveiller le climat social. Des enquêtes de satisfaction interne anonymes, réalisées périodiquement, peuvent détecter un problème latent (par exemple si un service particulier remonte des taux de stress anormalement hauts).
- Améliorer l’organisation du travail : une prévention efficace s’attaque aussi aux facteurs organisationnels qui peuvent favoriser le harcèlement. Par exemple, clarifier les rôles et responsabilités évite les confusions propices aux conflits. Assurer une charge de travail raisonnable et des délais tenables réduit le stress qui parfois dégénère en comportements agressifs. Promouvoir un management participatif et une communication bienveillante à tous les échelons aide à créer un climat de respect. En bref, il s’agit de favoriser une culture d’entreprise basée sur le respect, l’équité et l’inclusion, ce qui, de facto, réduit les risques de harcèlement. Les entreprises championnes en bien-être au travail mettent souvent en avant des valeurs fortes (respect, intégrité) et des codes de conduite stricts suivis par tous, y compris la direction.
| Fiche pratique – Éléments d’une politique anti-harcèlement réussie : À l’attention des employeuse.rs/RH, voici un bref aide-mémoire des composants essentiels d’un bon programme de prévention :Engagement de la direction : déclaration publique du/de la dirigeant.e soutenant la démarche, nomination d’un.e responsable de la prévention du harcèlement. Code de conduite : intégrer dans le règlement intérieur des clauses interdisant explicitement le harcèlement et la discrimination. Formation continue : prévoir un module de formation initiale pour tout nouvel entrant + des rappels annuels ou ateliers (incluant études de cas, jeux de rôles). Canaux de signalement sûrs : mettre en place au moins deux canaux (par exemple : un référent interne + une hotline externe anonyme) pour que les employé.e?s puissent signaler en toute confidentialité. Traitement des plaintes : établir une procédure interne (délais, enquête impartiale, protection contre les représailles, feedback vers la victime). Simuler des cas pour tester la réactivité. Suivi et évaluation : tenir un registre (anonymisé) des incidents signalés, analyser les causes, faire un bilan annuel devant le CHSS (Comité Hygiène, Santé et Sécurité) ou les représentant.e.s du personnel, ajuster les actions.En appliquant ces principes, une organisation maximise ses chances de prévenir efficacement le harcèlement et d’instaurer un climat de travail serein. |
Enfin, il convient de noter que la prévention du harcèlement est alignée avec d’autres démarches de bien-être au travail : promotion de la diversité, prévention du burnout, lutte contre le stress. Tous ces efforts convergent pour créer un milieu où chacun se sent respecté et en sécurité – ce qui bénéficie tant aux employé.e.s qu’à la performance de l’entreprise.
5.2 Mécanismes de signalement et accompagnement des victimes
Même avec les meilleures mesures de prévention, des situations de harcèlement peuvent survenir. Il est alors crucial qu’elles puissent être signalées et traitées rapidement, dans le respect et le soutien des personnes affectées. Cette sous-section détaille comment organiser des mécanismes de signalement internes fiables, et comment accompagner la victime (et éventuellement le/a harceleur/se) durant et après le processus.
Faciliter la parole : Un constat préoccupant des études internationales est que près de la moitié des victimes de harcèlement n’en parlent à personne au moment des faits, au Maroc ce chiffre avoisine les 90%. Les raisons couramment invoquées pour ce silence sont la peur que le signalement soit inutile (“perte de temps” citée par 55 % des victimes silencieuses) et la crainte des représailles ou pour sa réputation (45 %). Partant de là, les organisations doivent lever ces freins en assurant des canaux de signalement dignes de confiance. Il s’agit de garantir la confidentialité des plaintes, de protéger les plaignants contre tout risque de représailles, et d’afficher une réelle volonté d’agir suite aux signalements (sinon la défiance s’installe).
Concrètement, la mise en place d’un dispositif de signalement interne inclut souvent :
- un ou plusieurs interlocuteurs/trice dédié.es (par exemple : la.e manager RH, un.e référent.e harcèlement formé.e, ou un médiatrice/teur externe) vers qui les employé.e.s peuvent se tourner en cas de problème.
- la possibilité de faire un signalement anonyme ou confidentiel (boîte mail ou numéro de téléphone spécifique, éventuellement géré par un tiers externe pour plus d’indépendance).
- une procédure formalisée assurant que chaque signalement fera l’objet d’une enquête impartiale (souvent confiée à une petite commission incluant la RH et un.e représentant.e du personnel) et que les résultats seront suivis d’effets si le harcèlement est avéré.
Il est essentiel de communiquer sur ces mécanismes : les employé.e.s doivent savoir à qui s’adresser, sans hésitation. Des affiches, notes de service ou rappels lors des formations peuvent y contribuer. Au Maroc, par exemple, certaines grandes entreprises ont instauré des « boîtes à suggestions » accessibles à tous pour recueillir de manière anonyme des plaintes ou alertes.
Prise en charge des victimes : Lorsqu’un cas de harcèlement est signalé, la priorité est de protéger et soutenir la victime. Cela peut impliquer, dès les premières étapes, de la soulager de la proximité avec le.a harceleur.se (par exemple en la changeant provisoirement d’équipe ou de poste si elle le souhaite, le temps de l’enquête), ou de lui accorder un congé payé si son état psychologique le justifie. L’entreprise devrait mettre à disposition un soutien psychologique: certain.es employeuse.rs proposent aujourd’hui un service d’aide aux employé.e;s (EAP) avec des psychologues joignables en toute confidentialité. Le.a médecin du travail doit aussi être mobilisé.e comme actrice.eur clé, car elle/il peut constater l’altération de la santé de la victime, recommander des aménagements ou un arrêt. Écouter la victime avec empathie et sans jugement est la base: il faut l’encourager à détailler les faits, la remercier d’avoir eu le courage de parler, et lui assurer que sa parole sera prise au sérieux. Le management doit lui exprimer son soutien et la tenir informée des étapes à venir.
Gestion de l’enquête : L’enquête interne sur un présumé harcèlement doit être menée rapidement et objectivement. Les principes de base : respecter le contradictoire (entendre la version de la personne mise en cause, qui a droit à la présomption d’innocence), recueillir des témoignages de collègues ou d’autres personnes si disponible, et rassembler toute preuve matérielle (emails, messages, etc.). L’objectif est de faire la lumière tout en évitant de “re-victimiser” la personne harcelée par des interrogatoires maladroits. Si l’entreprise n’a pas l’expertise en interne, elle peut faire appel à un.e médiatrice.eur professionnel.le ou un cabinet spécialisé en risques psychosociaux pour conduire les entretiens de manière neutre.
| Encadré : Le rôle des témoins – Les collègues qui ont été témoins (directs ou indirects) d’un harcèlement jouent un rôle déterminant. Ils peuvent apporter un soutien moral précieux à la victime et leurs témoignages sont souvent décisifs pour établir les faits. Il est donc important de créer une culture où les témoins ne restent pas passifs. Des campagnes “See something, say something” (“Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose”) incitent par exemple les employés à signaler toute observation de comportement inapproprié, même s’ils n’en sont pas victimes. Le droit marocain, comme d’autres, protège les témoins de bonne foi : ils ne peuvent être sanctionné.e.s pour avoir témoigné sur des faits de harcèlement. Être témoin actif, c’est contribuer à stopper l’engrenage du harcèlement avant qu’il ne détruise des vies. |
Accompagnement post-incident : Une fois les mesures prises (sanction, éloignement du harceleur.se, voir section suivante), la victime aura sans doute besoin d’un suivi. Reprendre confiance et se reconstruire peut nécessiter un accompagnement thérapeutique sur plusieurs mois (thérapie, coaching). L’entreprise peut, par humanité et pour montrer l’exemple, financer ou faciliter cet accompagnement. Par ailleurs, si la victime a été arrêtée longtemps, la phase de réintégration dans le collectif doit être préparée (entretien de retour progressif, aménagement d’horaires, etc.). Il en va de même pour l’équipe : il peut être utile d’organiser, après coup, une session de débriefing collectif (animée éventuellement par un.e intervenant.e externe) afin de permettre aux collègues d’exprimer leur ressenti, de tirer les leçons et de recréer du lien après l’épisode de crise.
| Fiche pratique – Que faire si je suis victime de harcèlement ? (à l’attention des salarié.e.s) : Face à une situation de harcèlement, il est normal de se sentir déstabilisé.e. Voici quelques étapes conseillées pour réagir :Ne restez pas isolé.e – Parlez-en à une personne de confiance : collègue, représentant du personnel, ami, membre de la famille. Le simple fait de verbaliser aide et vous obtiendrez du soutien moral. Documentez les faits – Tenez un journal des incidents avec dates, lieux, descriptions et éventuels témoins. Conservez les preuves matérielles (emails, SMS, notes) qui attestent du harcèlement. Ces éléments vous seront utiles pour étayer votre éventuelle plainte. Consultez si besoin – Ne laissez pas votre santé se dégrader. N’hésitez pas à consulter la.e médecin du travail ou un.e médecin traitant pour parler de la situation et faire constater l’impact sur votre santé (physique ou mentale). Elles/Ils pourront vous conseiller un arrêt de travail si nécessaire et appuyer vos démarches. Alertez officiellement – Utilisez les mécanismes de signalement de votre entreprise (contactez le référent harcèlement, la DRH, ou écrivez un courrier à votre direction) pour déclarer ce que vous subissez. Soyez factuel.le dans la description. Si votre entreprise n’a pas de procédure, adressez-vous à l’Inspection du travail ou, le cas échéant, déposez plainte auprès des autorités (police/gendarmerie) notamment en cas de harcèlement sexuel ou d’agression. Au Maroc, vous pouvez contacter le numéro vert 8350 pour signaler tout harcèlement ou violence. Entourez-vous – Sur le plan juridique, rapprochez-vous d’un.e délégué.e syndical.e s’il y en a, ou d’une association spécialisée. Ils peuvent vous conseiller sur vos droits (p. ex. possibilité de saisir le tribunal pour résiliation du contrat aux torts de l’employeur.se si le harcèlement est avéré). Sur le plan psychologique, ne restez pas seul.e : s’il existe une cellule d’écoute ou un psychologue d’entreprise, utilisez ce service. Sinon, envisagez de consulter un psychologue extérieur pour vous aider à traverser cette épreuve.Rappelez-vous : le harcèlement n’est jamais acceptable, et vous n’êtes pas fautif/fautive de le subir. Oser en parler est difficile, mais c’est le premier pas pour faire cesser la situation. |
| Fiche pratique : Manager une équipe après un cas de harcèlement(Conseils aux managers pour reconstruire la confiance et communiquer avec l’équipe post‑incident)Objectif de la fiche : Donner aux responsables d’équipe des outils pratiques pour gérer les conséquences d’un cas de harcèlement, restaurer un climat de travail sain et prévenir les tensions ou la stigmatisation après un incident.1. Adopter une posture de leadership responsableReconnaître la gravité : Sans entrer dans les détails du dossier, exprimer clairement que le harcèlement est pris au sérieux et contraire aux valeurs de l’entreprise.Rester neutre et factuel : Éviter les jugements et respecter la confidentialité des personnes impliquées.Prendre le temps : Laisser l’équipe s’exprimer dans un cadre sécurisé, tout en orientant la discussion vers la reconstruction.2. Communiquer efficacement avec l’équipeInformer sans dévoiler : Expliquer les démarches en cours (enquête interne, sanctions prévues par le règlement) sans citer de noms ni partager de détails sensibles.Rassurer : Réaffirmer l’engagement de la direction en faveur d’un environnement sûr et respectueux.Répondre aux inquiétudes : Être disponible pour des échanges individuels, notamment avec les personnes impactées indirectement.3. Reconstruire la confiance et le climat d’équipeProposer un accompagnement collectif : Sessions de médiation, ateliers de cohésion, ou intervention d’un psychologue du travail si nécessaire.Mettre en place un plan d’action : Rappel des règles de conduite, actualisation du règlement intérieur, désignation d’un référent harcèlement.Favoriser la participation : Impliquer l’équipe dans l’élaboration de solutions concrètes pour prévenir de nouveaux incidents.4. Prévenir la récidiveFormer les managers et collaborateurs : Organiser des sessions régulières sur la prévention du harcèlement et la communication non violente.Suivre le climat social : Réaliser des enquêtes internes anonymes pour détecter les tensions.Renforcer les dispositifs de signalement : Veiller à ce que chaque collaboratrice/eur connaisse les canaux internes et externes de plainte (RH, inspection du travail, autorités).Points clés à retenirLa confidentialité est essentielle pour protéger les personnes impliquées.La communication doit être transparente, mais cadrée.La reconstruction d’un climat de confiance nécessite du temps, de l’écoute et des actions concrètes. |
5.3 Sanctions et recours juridiques
Lorsqu’une situation de harcèlement est avérée, il est indispensable d’apporter une réponse ferme afin de sanctionner le comportement fautif et d’empêcher sa répétition. Cette réponse se joue à deux niveaux : au niveau de l’entreprise d’abord (mesures disciplinaires internes, voire pénales si elle porte plainte), et au niveau de la justice si la victime choisit d’engager une action judiciaire contre le harceleur.se ou l’employeur.se. Cette sous-section clarifie les types de sanctions possibles et les recours ouverts aux victimes.
Sanctions disciplinaires internes : Dans le cadre de la gestion interne, un.e employeur.se confronté.e à un cas de harcèlement commis par l’un.e de ses employé.e.s (par exemple, un.e manager.e qui harcèle un.e subordonné.e) a l’obligation d’agir. En général, le harcèlement est considéré comme une faute grave justifiant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave du/de la salarié.e harceleur.se. Cette sévérité est inscrite dans la loi marocaine : comme mentionné plus haut, tout acte de harcèlement est une faute grave selon l’article 40 du Code du travail, ce qui légitime la rupture du contrat de travail du fautif sans indemnité. L’employeur.e, en prenant une telle sanction, envoie un message clair de tolérance zéro et protège l’ensemble du personnel. Des sanctions moindres peuvent être envisagées dans des cas de harcèlement “mineur” ou débutant (avertissement, mise à pied temporaire, mutation disciplinaire), mais il est crucial de ne pas minimiser les faits. Parfois, l’entreprise peut proposer une médiation entre le.a harceleur.se et la victime, notamment si le.a harceleur.se reconnaît ses torts et que la victime est en accord, mais ce processus doit être mené par un.e professionnel.le et n’est adapté qu’à des cas légers. Dans les cas graves, la séparation (licenciement) est souvent la seule issue saine.
Poursuites pénales : Lorsque le harcèlement revêt une dimension pénale (ce qui est le cas du harcèlement sexuel, ou du harcèlement moral répété ayant altéré la santé de la victime), la victime peut décider de porter plainte auprès des autorités judiciaires. Au Maroc, le harcèlement sexuel est explicitement criminalisé: l’auteur reconnu coupable risque une peine d’emprisonnement (par exemple, de un à six mois selon la gravité et le contexte, peine qui peut être alourdie si l’auteur.e est un.e supérieur.e hiérarchique) et une amende. Le harcèlement moral en tant que tel n’est pas toujours défini clairement dans le Code pénal, mais les violences verbales, menaces, ou conditions de travail contraires à la dignité peuvent tomber sous d’autres qualifications pénales. Les victimes ont la possibilité de se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice subi (dommages-intérêts). Par ailleurs, l’employeur.se peut elle-lui-même déposer plainte s’il/ elle estime que des faits délictueux ont eu lieu sur le lieu de travail (agression sexuelle, violences physiques) – ce faisant, il montre son engagement à faire respecter la loi.
Recours civils et prud’homaux : Sur le plan du droit du travail, une victime de harcèlement peut saisir le tribunal du travail (Conseil de prud’hommes) pour divers motifs. Si c’est un collègue ou un.e supérieur.e qui est l’auteur.e, la victime peut reprocher à l’employeur.se son manquement à l’obligation de sécurité (obligation de protéger la santé des salarié.e.s). Dans certains cas, le harcèlement est reconnu comme un motif de prise d’acte ou de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.se : la.e salarié.e quitte l’entreprise et le juge requalifie cela en licenciement sans cause réelle et sérieuse (donnant droit à des indemnités). Ce type de recours a été admis par la jurisprudence marocaine, notamment si la.e salarié.e prouve qu’il/elle a été contraint.e de démissionner à cause de faits de harcèlement (pour cela, il/elle doit avoir démissionné dans un délai rapproché des faits, sans attendre plusieurs années, sinon la justice peut estimer qu’il n’y a pas de lien direct ). Le juge peut octroyer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral et professionnel subi, en plus des indemnités de rupture classiques.
Responsabilité de l’employeur.se : Il convient de souligner que la loi tient souvent l’employeur.se comme responsable de ce qui se passe dans son entreprise. Ainsi, même si le harcèlement est le fait d’un individu, la victime peut se retourner contre l’employeur.se pour non-prévention ou non-intervention. Au Maroc, la réglementation sur la santé et sécurité au travail oblige l’employeur.se à prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité psychologique. S’il est démontré qu’il.elle a laissé faire (ou pire, qu’il.elle est lui.elle-même le.a harceleur.se), sa responsabilité est engagée. Des entreprises ont été condamnées à verser de lourdes indemnités pour ne pas avoir su empêcher un harcèlement pourtant connu de la hiérarchie.
Après la sanction : Enfin, une fois le.a harceleur.se sanctionné.e ou écarté.e, l’entreprise devrait tirer les enseignements de l’incident. Une analyse “à froid” peut être menée pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné (détection trop tardive ? lacune dans la politique interne ? manager sous pression qui a vrillé ?), et renforcer les mesures de prévention en conséquence. C’est une boucle d’amélioration continue. De plus, il est parfois opportun de communiquer en interne sur l’issue de l’affaire (sans forcément nommer les personnes) afin de réaffirmer les valeurs de l’entreprise et rassurer le personnel sur le fait que le problème a été pris à bras-le-corps.
| Encadré : Exemple de jurisprudence marocaine – Dans un arrêt de la Cour de cassation marocaine de 2016, une salariée avait démissionné en accusant son supérieur de harcèlement moral (pressions constantes, propos rabaissants). La Cour a confirmé que lorsque des comportements abusifs de l’employeur forcent le salarié à la démission, cela équivaut à un licenciement abusif. Cependant, la Cour a aussi précisé que la victime doit agir dans un délai raisonnable : dans l’affaire en question, les faits de harcèlement remontaient à plus de 3 ans et la démission n’était intervenue qu’en dernier lieu – trop tard selon la Cour pour établir un lien direct. La leçon à retenir pour les salarié.e.s est qu’il ne faut pas tarder à faire valoir ses droits dès lors que le harcèlement devient insupportable. |
Du côté pénal, un cas connu est celui d’un chef d’entreprise condamné en 2019 pour harcèlement sexuel envers plusieurs de ses employées, suite à la plainte collective de celles-ci. Le tribunal a non seulement prononcé une peine de prison avec sursis et une amende contre le harceleur, mais a aussi alloué à chaque victime des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi. Ce genre de condamnation, relayée dans la presse, a un effet dissuasif et encourage d’autres victimes à parler.
En somme, sanctionner le harcèlement est indispensable pour rendre justice à la victime, rétablir l’ordre dans l’entreprise et prévenir la récidive. Employeurs et autorités doivent travailler de concert : l’entreprise traite en interne rapidement, et la justice punit si nécessaire. La crédibilité de la lutte anti-harcèlement en dépend.
6. Outils Pratiques et Ressources
Ce chapitre final regroupe divers outils pratiques, fiches et ressources destinés à aider les lectrices et les lecteurs à approfondir le sujet ou à passer à l’action. Il compile en quelque sorte les éléments concrets disséminés dans le guide pour en faire une synthèse opérationnelle. On y trouvera des fiches pratiques résumant les étapes-clés ou les bonnes pratiques (certaines ont déjà été présentées en encadré dans les sections précédentes), des encadrés explicatifs reprenant les notions importantes (définitions, chiffres marquants), ainsi qu’une liste de ressources utiles (adresses des liens vers des guides internationaux, contacts d’organismes au Maroc, etc.). L’objectif est qu’à l’issue de la lecture du guide, la lectrice et le lecteur disposent d’un véritable kit pour agir contre le harcèlement au travail.
6.1 Fiches pratiques pour les employeur.e.s et les salariés
Récapitulatif des fiches pratiques :
- Fiche n°1 : Élaborer une politique anti-harcèlement (checklist des éléments à inclure, voir section 5.1)
- Fiche n°2 : Reconnaître les signes de détresse chez un collègue (comment identifier un possible cas de harcèlement, voir section 4.1)
- Fiche n°3 : Que faire si je suis victime ? (démarches conseillées aux salarié.es, voir section 5.2)
- Fiche n°4 : Manager une équipe après un cas de harcèlement (conseils aux managers pour reconstruire la confiance et communiquer avec l’équipe post-incident)
- Fiche n°5 : Droits du salarié.e harcelé.e au Maroc (récapitulatif juridique : droit de retrait, dépôt de plainte, etc., voir sections 2.2 et 5.3)
Ces fiches sont conçues pour être pratiques et concises – lues en quelques minutes, avec des listes à puces et des verbes d’action. Elles peuvent être imprimées depuis la version web du guide, afin de servir de mémo sur le lieu de travail.
6.2 Encadrés explicatifs et données illustratives
Au fil du guide, plusieurs encadrés explicatifs et données illustratives ont été proposés, mettant en lumière des points saillants. Pour faciliter la lecture, on les répertorie ici :
- Définition du harcèlement (OIT) – encadré section 1 : définition large couvrant tous les comportements inacceptables, qu’ils soient isolés ou répétés.
- Convention n°190 – points clés – encadré section 2.1 : synthèse de la convention internationale, droits et mesures à prendre.
- La loi marocaine en bref – encadré section 2.2 : rappel de l’article 40 du Code du travail et du dispositif juridique national.
- Données mondiales par région – figure et tableau section 3.2 : statistiques comparatives (monde, Amériques, Afrique, etc. ).
- Profil des femmes au Maroc – encadré section 3.3 : statistiques HCP 2019 sur les catégories les plus touchées (jeunes, urbaines, etc. ).
- Témoignage/cas d’entreprise – encadré section 4.2 : histoire réelle (anonymisée) illustrant les impacts organisationnels d’un harcèlement.
- Rôle des témoins – encadré section 5.2 : encouragement et protection des salariés témoins d’un cas de harcèlement.
- Jurisprudence marocaine – encadré section 5.3 : exemple concret d’affaire portée en justice, avec enseignements.
Chacun de ces encadrés apporte un éclairage particulier : soit en approfondissant une notion-clé, soit en fournissant un exemple concret, soit en présentant un chiffre marquant. Visuellement sur le web, ces encadrés apparaissent dans un style différencié (cadre et fond coloré) pour attirer l’attention des lectrices et des lecteurs sur ces informations importantes.
6.3 Ressources et contacts utiles
Pour terminer, nous listons ici quelques ressources complémentaires et contacts utiles, afin que les lectrices et les lecteurs qui souhaitent en savoir plus ou obtenir de l’aide puissent le faire aisément :
- Guides et publications internationales :
- Guide pratique de l’OIT “Violence et harcèlement au travail” (édition 2022) – Un manuel à destination des employeur.ess avec définitions, exemples et conseils concrets.
- Directives de l’OMS sur la santé mentale au travail (2022) – Incluant des recommandations spécifiques sur la prévention du harcèlement et du stress.
- Rapport de l’OIT “Experiences of violence and harassment at work: A global first survey” (2022) – Rapport détaillé de l’enquête mondiale, avec annexes statistiques par région.
- Publications de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur les risques psychosociaux – incluent des outils d’évaluation du harcèlement.
- Guide pratique de l’OIT “Violence et harcèlement au travail” (édition 2022) – Un manuel à destination des employeur.ess avec définitions, exemples et conseils concrets.
- Ressources au Maroc :
- Associations et ONG locales : L’Union de l’Action Féminine (UAF), LDDF ; l’ADFM et l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) ont des cellules d’écoute pour les femmes victimes de violences, y compris au travail.
- Syndicats : Les grandes centrales syndicales (UGTM, UMT, CDT…) disposent de services juridiques pouvant accompagner les salarié.e.s harcelés dans leurs démarches (renseignements sur le droit, aide à constituer un dossier de plainte).
- Textes juridiques :
- Texte du Code du travail marocain (articles relatifs au harcèlement : art. 40, art. 532 …) – disponible sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.
- Texte du Code pénal marocain (articles sur le harcèlement sexuel, ex: art. 503-1) – également sur le site du SGG.
- Convention OIT n°190 – accessible en français sur le site de l’OIT.
- Texte du Code du travail marocain (articles relatifs au harcèlement : art. 40, art. 532 …) – disponible sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.
En outre, nous proposons en annexes 3 un modèle de formulaire de signalement interne (anonyme) que les entreprises peuvent adapter, et en annexe 4 un modèle de politique anti-harcèlement prêt à l’emploi.
7. Conclusion
7.1 Synthèse des points clés
Le harcèlement au travail, qu’il soit moral, physique ou sexuel, est un fléau aux multiples facettes qui concerne toutes les régions du monde et tous les secteurs d’activité. Au fil de ce guide, nous avons mis en évidence plusieurs points clés :
- Un phénomène d’ampleur mondiale : Plus de 22 % des travailleuse.rs dans le monde ont été victimes de harcèlement au travail au cours de leur vie professionnelle, avec des variations régionales notables (jusqu’à un tiers des travailleuse.rs dans certaines régions) et une surexposition de certains groupes (femmes, jeunes, etc.). Au Maroc, environ 15 % des femmes actives subissent harcèlements et violences au travail chaque année, ce qui révèle que le problème est bien présent et nécessite une attention locale soutenue.
- Des conséquences graves : Le harcèlement n’est pas un conflit anodin ; il provoque une souffrance psychologique intense (stress, dépression, syndrome post-traumatique) et peut aller jusqu’à détruire la santé physique de la victime. Son impact s’étend à la famille de la victime (tensions, isolement) et à l’ensemble de l’entreprise (climat délétère, démotivation, absentéisme, baisse de productivité). Les coûts humains et économiques sont immenses, justifiant une tolérance zéro.
- Un renforcement normatif et une prise de conscience : Les deux dernières décennies ont vu l’émergence de normes internationales pionnières (Convention OIT 190) et de lois nationales plus strictes (au Maroc, pénalisation du harcèlement sexuel et reconnaissance du harcèlement comme faute grave dans le Code du travail). Parallèlement, la parole commence à se libérer et la société attend des employeuse.rs un comportement exemplaire sur ce sujet.
- La prévention, meilleure arme : Mieux vaut prévenir que guérir – les organisations doivent instaurer des politiques claires, former leurs équipes, nommer des référent.e.s, surveiller le climat social pour détecter tôt les signaux. Les guides de bonnes pratiques (OIT, OMS) offrent une feuille de route : impliquer la direction, former les managers, protéger les plus vulnérables, promouvoir une culture du respect. Un investissement en prévention est largement compensé par les bénéfices (bien-être accru, performance durable).
- Accompagner et sanctionner : Lorsqu’un cas survient malgré tout, il faut réagir vite : protéger la victime, enquêter impartialement, sanctionner le.a harceleur.se. Ni l’entreprise ni la justice ne doivent hésiter à appliquer les sanctions prévues – cela consolide la confiance et décourage les conduites futures. Les victimes disposent de recours variés pour obtenir réparation, et l’existence de ces recours doit être connue de tous (y compris la possibilité, en dernier ressort, de quitter l’entreprise en considérant la rupture comme un licenciement abusif de l’employeuse.r).
- Responsabilité partagée : La lutte contre le harcèlement concerne tout.e.s les actrices et les acteurs du monde du travail. Les employeur.es ont un devoir de sécurité envers leurs employé.e.s, les manager.e.s un devoir d’exemplarité, les collègues un devoir de solidarité (ne pas être complices silencieux), et les pouvoirs publics un devoir d’accompagnement (dispositifs de contrôle, aide aux victimes, incitations à la prévention). Ensemble, en faisant front commun, il est possible de faire reculer ce phénomène.
En synthèse, le harcèlement au travail est antithétique du travail décent et de la performance saine d’une organisation. Aucune entreprise ne peut se permettre d’ignorer ce sujet, et chaque travailleuse.r a le droit fondamental d’exercer son métier sans peur, dans le respect de sa dignité.
7.2 Engagements futurs et perspectives
En 2025 et au-delà, plusieurs défis et pistes d’action se dessinent pour poursuivre le combat contre le harcèlement au travail :
- Renforcer la mise en œuvre des normes : L’adoption de lois est une étape, leur application effective en est une autre. Il faudra s’assurer que les mécanismes de plainte (en interne et externes) fonctionnent correctement, que les inspectrice.eur.s du travail soient formé.e.s à repérer et traiter les cas de harcèlement, et que les tribunaux traitent diligemment les contentieux de ce type. Au Maroc, l’enjeu sera de faire connaître la loi 103-13 et les dispositions du Code du travail aux employés comme aux employeuse.rs, surtout dans les PME et le secteur informel.
- Étendre la ratification de la Convention 190 : Au niveau international, encourager davantage de pays à ratifier la C190 de l’OIT contribuera à harmoniser les efforts. Le Maroc envisage cette ratification – ce qui serait un signal fort s’il le fait, en alignant encore mieux sa législation et en s’engageant à des rapports réguliers sur les progrès réalisés.
- Éducation et changement de culture : La prévention commence dès l’éducation. Il serait bénéfique d’intégrer dans les programmes de formation (écoles, universités, formation professionnelle) des modules sur le respect d’autrui, la gestion des conflits, l’égalité et la lutte contre le harcèlement. Créer une culture d’entreprise bienveillante prend du temps : cela passe par le leadership exemplaire, mais aussi par impliquer les employé.e.s (par ex., via des campagnes internes, des semaines de la qualité de vie au travail centrées sur le respect).
- Focus sur le numérique : L’essor du télétravail et des outils numériques amène de nouvelles formes de harcèlement (cyber-harcèlement via emails, messageries, etc.). Les politiques devront intégrer ces dimensions (charte d’utilisation des outils numériques, modération des échanges en ligne professionnels).
- Soutien aux victimes : Continuer d’améliorer la prise en charge des victimes, notamment en multipliant les structures d’accueil (cellules de soutien psychologique accessibles gratuitement). Au Maroc, cela pourrait se traduire par la création de “cellules anti-harcèlement” régionales, regroupant juristes, psychologues, inspectrices et inspecteurs, où les victimes seraient orientées efficacement.
- Mesurer pour progresser : Enfin, il faudra affiner le suivi statistique. Des enquêtes régulières (tous les 5 ans par exemple) sur le climat de travail et le harcèlement, tant au niveau mondial (peut-être une répétition de l’enquête OIT-Gallup) qu’au niveau national (inclusion de questions spécifiques dans les enquêtes emploi du HCP), permettraient de mesurer les évolutions et d’ajuster les politiques publiques et d’entreprise.
L’éradication complète du harcèlement au travail reste un idéal vers lequel tendre. Chaque action compte pour s’en rapprocher. En combinant une volonté politique, une implication sincère des employeur.se.s et une vigilance de tous les instants de la part des travailleuse.rs elles/eux-mêmes, on peut faire du lieu de travail un espace de coopération, de confiance et de respect mutuel. Ce guide, en offrant informations et outils, espère y contribuer. La prochaine étape appartient à chacun.e de nous : appliquer ces connaissances et promouvoir activement, au quotidien, des comportements bienveillants pour que le “Travail décent” prôné par l’OIT devienne une réalité vécue par tous, au Maroc comme ailleurs.
Annexes
Annexe 1 : Références bibliographiques
- Organisation Internationale du Travail (2022). Violence et harcèlement au travail : Un guide pratique pour les employeurs. Genève : OIT.
- Organisation Internationale du Travail, Lloyd’s Register Foundation & Gallup (2022). Experiences of violence and harassment at work: A global first survey. Genève : OIT.
- Haut-Commissariat au Plan (2020). Enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes 2019 – Principaux résultats. Rabat : HCP.
- INRS France (2022). Harcèlement moral et violences internes : conséquences pour les salariés et l’entreprise. Paris : INRS.
- Beswic (Belgique) (2022). L’OMS et l’OIT appellent à de nouvelles mesures pour la santé mentale au travail. (Note d’actualité résumant les directives OMS).
- Code du Travail Marocain, Article 40 (faute grave – harcèlement). Code Pénal Marocain, Article 503-1 (harcèlement sexuel).
Annexe 2: Textes juridiques marocains sur la violence et le harcèlement
| Code/Loi (référence) | Texte intégral de l’article | Remarques |
| Code du Travail (Loi n° 65-99) – Article 40 | « Sont considérées comme fautes graves commises par l’employeur, le chef de l’entreprise ou de l’établissement à l’encontre du salarié :- l’insulte grave ;- la pratique de toute forme de violence ou d’agression dirigée contre le salarié ;- le harcèlement sexuel ;- l’incitation à la débauche.Est assimilé à un licenciement abusif le fait pour le salarié de quitter son travail en raison de l’une des fautes énumérées au présent article, lorsqu’il est établi que l’employeur a commis l’une de ces fautes. » | Le Code du travail qualifie ces actes (insulte grave, violence, harcèlement sexuel, etc.) de fautes graves de l’employeur, ouvrant droit pour le salarié à considérer son départ comme un licenciement abusif. |
| Code Pénal – Article 503-1 | « Est coupable de harcèlement sexuel et puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, quiconque, en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, harcèle autrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. » | Incrimine le harcèlement sexuel commis par abus d’autorité (rapport hiérarchique). Introduit par la loi n° 24-03 de 2003, avec peines alourdies en 2018 par la loi n° 103-13. |
| Code Pénal – Article 503-1-1 | « Est coupable de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces peines, quiconque persiste à harceler une autre personne dans les situations suivantes : 1° dans les espaces publics ou autres, au moyen d’actes, de paroles ou de signes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles ; 2° par le biais de messages écrits ou électroniques, d’enregistrements ou de photographies à caractère sexuel ou à des fins sexuelles. La peine est portée au double si l’auteur est un collègue de travail ou une personne chargée du maintien de la sécurité et de l’ordre dans les espaces publics ou autres. » | Introduit par la loi n° 103-13 en 2018, il élargit l’incrimination du harcèlement sexuel hors cadre d’autorité (ex. harcèlement de rue, cyberharcèlement). La peine est aggravée si le harceleur est collègue de travail ou agent chargé de la sécurité publique. |
| Code Pénal – Article 503-1-2 | « La peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le harcèlement sexuel est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime un empêchement à mariage, un tuteur, une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge, ou un kafil, ou si la victime est un mineur. » | Créé par la loi n° 103-13, cet article prévoit une circonstance aggravante de harcèlement sexuel (peine portée à 3–5 ans de prison) lorsque l’auteur est un membre de la famille ou une personne en position d’autorité particulière vis-à-vis de la victime, ou si la victime est mineure. |
| Code Pénal – Art 489 | « Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. » | Criminalise les relations homosexuelles (considérées comme “actes contre nature”) entre deux personnes de même sexe consentantes. |
| Code Pénal – Art 490 | « Sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles. » | Criminalise les relations sexuelles hors mariage (délit de zina) entre un homme et une femme non mariés. |
Annexe 3 : Modèle de formulaire de signalement interne (anonyme)
(Conforme au Code du travail – art. 40 et à la loi 103‑13)
| Titre : Formulaire de signalement anonyme – Harcèlement et violences au travailInstructions : Ce formulaire est destiné à signaler, de manière anonyme si vous le souhaitez, toute situation de harcèlement moral, sexuel ou de violence au sein de l’entreprise. Il sera transmis au comité interne de traitement des plaintes.A. Informations sur la situationDate de l’incident ou période concernée : ………………… Lieu où s’est produit l’incident (bureau, atelier, espace public lié à l’entreprise, etc.) : ………………… Décrivez les faits (mots, gestes, comportements, messages…) : ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………B. Informations sur la personne mise en causeFonction / poste (si connu) : ………………… Relation avec vous (supérieur, collègue, client, autre) : …………………C. Témoins éventuelsNoms ou fonctions (si connus) : …………………D. Conséquences sur vous / votre travail …………………………………………………………………………………E. Souhaitez-vous être contacté.e par le comité pour un suivi (tout en restant anonyme si possible) ? ☐ Oui ☐ NonRemarques :Ce formulaire est traité de manière confidentielle. Il peut être déposé dans une boîte sécurisée prévue à cet effet ou envoyé par e‑mail à l’adresse dédiée. |
Annexe 4 : Modèle de politique de Direction Générale anti-harcèlement
(Prête à l’emploi – à intégrer au règlement intérieur et diffuser dans l’entreprise)
| Titre : Politique de tolérance zéro contre le harcèlement et les violences au travailPréambule : Conformément au Code du travail (art. 40) et à la loi 103‑13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, notre entreprise adopte une politique de tolérance zéro envers toute forme de harcèlement, de discrimination ou de violence au travail.1. Champ d’applicationCette politique s’applique à tous les employé.e.s, quel que soit leur statut (CDI, CDD, stagiaires, sous-traitants), ainsi qu’aux client.e.s, fournisseurs et visiteuses.rs.2. DéfinitionsHarcèlement sexuel : tout comportement verbal, non verbal ou physique à caractère sexuel non désiré (Code pénal, art. 503‑1 à 503‑1‑2). Harcèlement moral : toute conduite abusive portant atteinte à la dignité ou dégradant les conditions de travail. Violences au travail : tout acte d’agression, menace ou intimidation physique ou psychologique.3. Engagement de la DirectionPrévenir toute forme de harcèlement par des formations et campagnes de sensibilisation. Protéger les victimes par des mécanismes de signalement sécurisés et confidentiels. Sanctionner toute violation de cette politique, conformément aux dispositions légales et au règlement intérieur.4. Procédure de signalementMise à disposition d’un formulaire de signalement (voir modèle ci‑joint), pouvant être rempli de manière anonyme. Examen des signalements par un comité interne formé de représentant.e.s RH, syndicaux et d’un.e référent.e indépendant.e. Traitement sous 15 jours ouvrables avec retour d’information à la victime (si identifiée).5. Mesures de protectionAucune représaille ne sera tolérée contre les personnes ayant signalé de bonne foi. Possibilité de recourir à l’inspection du travail ou aux autorités judiciaires si nécessaire.6. SanctionsTout acte de harcèlement ou de violence entraîne des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave (art. 40 du Code du travail), et le cas échéant des poursuites pénales (loi 103‑13).Fait à …………………, le ………………… Direction Générale (Signature) |
Annexe 5: Vidéo de 5mn : STOP HARCÈLEMENT
Annexe 6 : Centres d’Écoute au Maroc -sélection-
Voici un tableau récapitulatif des centres d’écoute des associations en lutte contre les violences faites aux femmes au Maroc, avec les informations disponibles :
| Nom de l’association / centre | Mission | Téléphone | Adresse email | Adresse postale |
| Centre FAMA (AMDF) – Casablanca | Écoute, orientation juridique, soutien psychologique aux femmes victimes de violence | (212‑522) 45‑15‑35 | 282 angle Avenue Moukawana et rue Strasbourg, 3ᵉ étage, App. 311, Casablanca Le Matin.ma+15mites.gob.es+15Groupe SOS+15 | |
| Association Marocaine de Lutte contre la Violence à l’égard des Femmes (AMVEF) – Casablanca | Centre d’écoute et d’orientation pour femmes victimes de violence | 00212‑522‑268667 | amvef@gmail.com ; écoute@menara.ma | 37 Rue Abderrahman Sahraoui, App. 6, 5ᵉ étage, Casablanca mites.gob.eshotpeachpages.net |
| ADFM – Centre Nejma (section Rabat) | Écoute, orientation juridique et soutien psychologique via le centre Nejma de l’ADFM | 0537‑70‑60‑81 | association.adfm@gmail.com ; adfm.ass@gmail.com ; adfm.coordination@gmail.com | Rue Ibn Mokla, Villa 2 – Les Orangers, Rabat Mrawomen |
| LDDF – Centre d’écoute (Ligue Démocratique pour les Droits des Femmes) – Casablanca | Écoute, orientation juridique aux femmes victimes de violences | (212‑22) 22‑50‑47 / 49‑13‑63 | lddf@iam.net.ma ; ciofem@yahoo.fr | 314 Rue Mustapha El Maani, 2ᵉ étage, n°17, Casablanca hotpeachpages.net |
| AMDH (Association Marocaine des Droits Humains) – Rabat – siège national | Défense des droits humains et suivi des violences, accueil et accompagnement de victimes | 0537‑73‑09‑61 | amdh1@mtds.com ; amdh.info@yahoo.fr | N°1, Immeuble 6, Rue Aguensous, Av. Hassan II, Les Orangers, Rabat Ville Mrawomen |
Centre FAMA / AMDF (Casablanca)
Casablanca, Morocco
Écoute, soutien juridique et psychologique aux femmes victimes de violence mites.gob.es
LDDF – Ligue Démocratique pour les Droits des Femmes (Casablanca)
Casablanca, Morocco
Centre d’écoute et orientation juridique aux victimes mites.gob.es
Rabat, Morocco
Centre d’aide aux femmes victimes de violence (écoute, soutien juridique) EFI-RCSO
Agadir, Morocco
Centre régional d’aide aux femmes victimes de violence EFI-RCSO
Fès, Morocco
Centre régional d’aide aux femmes victimes de violence EFI-RCSO
Tanger, Morocco
Association de lutte contre la violence faite aux femmes et enfants, hébergement et soutien fr.associationamna.com
📋 Tableau des centres d’écoute et associations régionales
| Nom / Centre | Mission | Téléphone | Adresse postale | |
| Centre FAMA / AMDF (Casablanca) | Écoute, soutien juridique, orientation psychologique | (212‑522) 45‑15‑35 | écoute@casanet.net.ma | 282, angle Av. Moukawana & rue Strasbourg, 3ᵉ étage, Casabl. cawtarclearinghouse.orgWikipédia+4mites.gob.es+4cawtarclearinghouse.org+4 |
| LDDF – Ligue Démocratique (Casablanca) Réseau LDDF-INJAD | Écoute, orientation juridique aux victimes | (212‑22) 22‑50‑47 | lddf@iam.net.ma | 314 Rue Mustapha El Maani, 2ᵉ étage n°17, Casablanca mites.gob.es |
| Centre Annajda – UAF (Rabat) | Écoute, soutien juridique et social | 0537‑727222 | uaf.rabat@gmail.com | 425 Bd Hassan II, appt 13, 4ᵉ étage, Rabat EFI-RCSO |
| Centre Annajda – UAF (Agadir) | Centre régional d’aide aux femmes victimes | 0528‑232540 | uaf.agadir@yahoo.fr | Résidence Sidi Youssef, app. 128, Agadir EFI-RCSO |
| Centre Annajda – UAF (Fès) | Centre régional d’aide aux femmes victimes | 0535‑640692 | uaffesr@yahoo.fr | Rue Al Yarmouk, bâtiment 7 n°4 Lido, Fès EFI-RCSO |
| Association AMNA (Tanger) | Aide aux femmes/enfants victimes, hébergement | +212 (05) 39 33 16 17+212 (05) 39 33 16 18 | associationamna@yahoo.frcontact@associationamna.com | Tanger, 39, Boulevard Sidi Bouabid, ancienne maison de jeunesses.Tanger – Maroc fr.associationamna.com |
ℹ️ Informations complémentaires
- Le ministère de la Solidarité a mis en place plus de 100 centres d’accueil régionaux pour femmes victimes de violence, couvrant toutes les régions du Maroc ; ceux-ci offrent souvent une prise en charge globale, y compris liée au harcèlement professionnel Wikipédia+12mobile.telquel.ma+12cawtarclearinghouse.org+12.
- Plusieurs de ces centres – notamment ceux d’Annajda/UAF – disposent de cellules d’accueil multi-services (juridique, psychologique, hébergement) dans les tribunaux ou les commissariats, en conformité avec la loi 103‑13 mites.gob.es+3medias24.com+3EFI-RCSO+3.